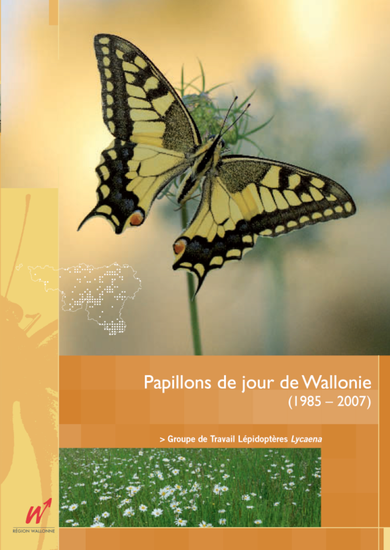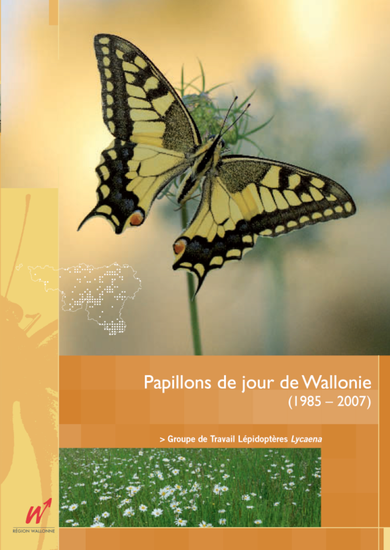
Le suivi des papillons de jour
Les papillons de jour ou Lépidoptères Rhopalocères sont un groupe d’insectes emblématique en même temps que fort menacé. Ils font l’objet d’un suivi de science citoyenne financé par le SPW depuis 1990 dans le cadre des programmes SURWAL (Surveillance de l’État de l’Environnement wallon par bioindicateurs), puis ISB (Inventaire et Surveillance de la Biodiversité).
Pourquoi suivre les papillons de jour ?
- Ils sont connus et appréciés de tous, assez aisés à observer et identifier sur le terrain avec une nombre d’espèces ni trop élevé (moins d’une centaine en Wallonie au cours des dernières années), ni trop faible
- Ce sont d’excellentes « sentinelles » en raison de leurs qualités d’indicateurs de l’état des milieux terrestres, réagissant très rapidement aux modifications des conditions environnementales, qu’il s’agisse de la végétation, de sa gestion, de la structure paysagère ou du climat
- Environ deux tiers des espèces indigènes de Wallonie sont en déclin, dont un peu plus de la moitié sont considérées comme menacées à des degrés divers et près d’un cinquième ont déjà disparu du territoire.
- Ce sont des porte-drapeaux idéaux, permettant d’orienter la gestion des espaces semi-naturels et de protéger de nombreux autres groupes biologiques par le biais des actions de conservation en leur faveur.
- Au total, 117 espèces des papillons de jour ont été répertoriées à ce jour en Wallonie, dont 8 sont des visiteurs accidentels.
- Parmi les 109 autres espèces, 21 sont éteintes régionalement et il ne subsiste donc que 88 espèces reproductrices, dont près de 40% au moins sont considérées comme menacées.
- 97 espèces ont été notées depuis 2010.
- 94 espèces ont été observées depuis 2020.
- La base de données rassemble aujourd’hui plus 1,2 millions d’observations.
- Plus de 100.000 données d’observation de papillons de jour sont enregistrées en moyenne par an depuis 2020.
- Plus de dix-huit mille observateurs ont fourni à ce jour des données de papillons de jour, parmi lesquels 230, plus de 1000 données et près de 1500 plus de 100 données.
Cycle de vie et observation
Le développement de ces insectes comprend quatre stades (œuf, larve ou chenille, pupe ou chrysalide, adulte ou imago). Dans nos régions, le cycle complet est assuré entre quelques semaines et deux ans, en fonction des espèces, mais une majorité ont un cycle d’un an, les autres, des cycles plus courts, avec de deux et à quatre générations par an.
L’hiver est passé à l’un des quatre stades selon les espèces, un certain nombre passant donc l’hiver au stade adulte. La période de vol des adultes varie d’une espèce à l’autre, en lien avec le stade hivernant : les espèces passant l’hiver au stade adulte sortent les premières au printemps (voire en fin d’hiver), puis dans l’ordre, celles ayant hiverné au stade chrysalide, chenille et œuf, ces dernières n’apparaissant qu’en été.
La vie adulte de la plupart des espèces ne dure que trois à quatre semaines tout au plus, et beaucoup moins en moyenne pour un individu donné, hormis pour celles qui passent l’hiver au stade adulte, dont la vie imaginale est de quelques mois.

Cycle du Damier de la succise (Euphydryas aurinia) © Gilles San Martin

© Gilles San Martin
L’activité des adultes est très dépendante des conditions météo en journée, ceux-ci ne prenant leur envol que si la température dépasse 12-13°C et que le soleil luit. Ils se posent le plus souvent très vite dès que les nuages cachent le soleil et sont plus difficiles à détecter dans la végétation dès qu’ils sont en position de repos. L’observation des papillons requiert donc d’effectuer les sorties par assez beau temps. Par ailleurs, la brièveté des périodes de vol de chaque espèce n’ayant qu’une génération par an implique de profiter de ces journées favorables au bon moment de l’année pour avoir des chances de les croiser.
Par conditions adéquates, la détection et l’observation de terrain sont assez aisées et l’identification possible, y compris à distance en s’aidant de jumelles à mise-au-point rapprochée, lorsqu’ils sont posés, et même aussi en vol avec un peu d’habitude. En phase d’initiation, la capture temporaire au filet est cependant très utile, ou alors la prise de photos avec un petit télé macro afin d’identifier les espèces ensuite.

© Violaine Fichefet
Objectifs des programmes de suivi
Ces programmes poursuivent deux objectifs principaux :
- L’inventaire de la biodiversité visant à répertorier les espèces sur un maximum de sites et mailles géographiques à travers le territoire wallon afin de préciser la distribution des espèces et d’identifier les sites les plus importants pour la préservation de cette biodiversité.
- La surveillance de la biodiversité cherchant à dégager les tendances de distribution et des populations de nos papillons, à détecter les espèces les plus menacées et à tenter de mettre en évidence les facteurs qui contribuent aux changements observés.
Alors que la logique "inventaire" implique des prospections très larges de façon à inventorier un maximum de sites, l'approche "surveillance" se base plutôt sur des relevés ciblés et récurrents sur un réseau de stations d'échantillonnage, dont une majorité abrite des espèces « prioritaires ».
Le Groupe de Travail "Lycaena"
©
© Violaine Fichefet
Ce Groupe de Travail réunit les naturalistes intéressés ou passionnés par les papillons de jour en Wallonie. Par la récolte d'informations anciennes et actuelles, il participe à la constitution d'une base de données rassemblant une masse considérable d'informations pour toutes les espèces présentes sur notre territoire.
Les collaborateurs sont invités et encouragés à effectuer des relevés sur un maximum de sites et mailles géographiques au cours de la saison favorable de mars à octobre et d’encoder leurs données sur des portails en ligne (système d'encodage de la Région wallonne ou sur Observations.be).
Le Groupe de travail Lycaena communique essentiellement via un forum de discussion et un groupe Facebook. Rassemblant des lépidoptéristes de tous horizons, il permet de partager ses découvertes et photos, de commenter les observations de la saison, d'échanger les informations à propos de nouvelles publications et d'organiser les recensements ou les éventuelles activités. Pour rejoindre le GT, deux possibilités :
- Le forum google
- La page facebook
Programmes et méthodes de suivi
Suivi de la distribution géographique
Espèces concernées : toutes les espèces wallonnes indigènes
Toutes les observations de papillons de jour, fortuites ou non, sont utiles et peuvent servir à préciser la distribution des espèces, dans l’espace et le temps. Il est donc recommandé d’encoder sur les portails en ligne toutes vos données, même récurrentes à un endroit donné. Les photos sont par ailleurs bienvenues afin de pouvoir valider les identifications.
Contrôle des stations des espèces prioritaires
Espèces ciblées : une quarantaine d’espèces menacées et/ou en déclin ou rares
Le principe est ici de visiter en rotation et à intervalle de quelques années au moins la majorité des stations connues des espèces les plus menacées et rares afin de vérifier le maintien de populations. Étant donné la détectabilité imparfaite, deux à trois visites effectuées par conditions favorables, sont nécessaires, au minimum lors d’une année de contrôle, afin de pouvoir contacter les espèces visées et conclure au maintien de celles-ci. Ces données sont traitées ensuite en présence/absence ou détection/non détection à l’aide de modèle statistiques adaptés.
Suivi de l’effectif des populations des espèces prioritaires
Espèces ciblées : une quarantaine d’espèces menacées et/ou en déclin ou rares
Ce suivi est réservé aux professionnels et amateurs éclairés du GT Lycaena. Il cible un échantillon de stations occupées par chacune des espèces prioritaires et fait principalement appel à une méthode proposée au niveau européen par « Butterfly Conservation » : les comptages de 15 minutes à l’aide de l’application pour smartphone eBMS.
Une espèce très menacée fait également l’objet de recensements des nids de chenilles en fin d’été : le Damier de la succise (Euphydryas aurinia).
Certaines espèces font l’objet de campagnes de CMR dans le cadre d’études écologiques par l’UCL. sont photographiés dans la mesure du possible afin de permettre l’identification des individus sur base de leurs dessins dorsaux de la tête et du corps, ce qui permet alors des estimations d’effectifs par les méthodes d’analyses de données de « capture-marquage-recapture » ou CMR, plutôt que des mesures d’abondances relatives fournies par les comptages.
Publications