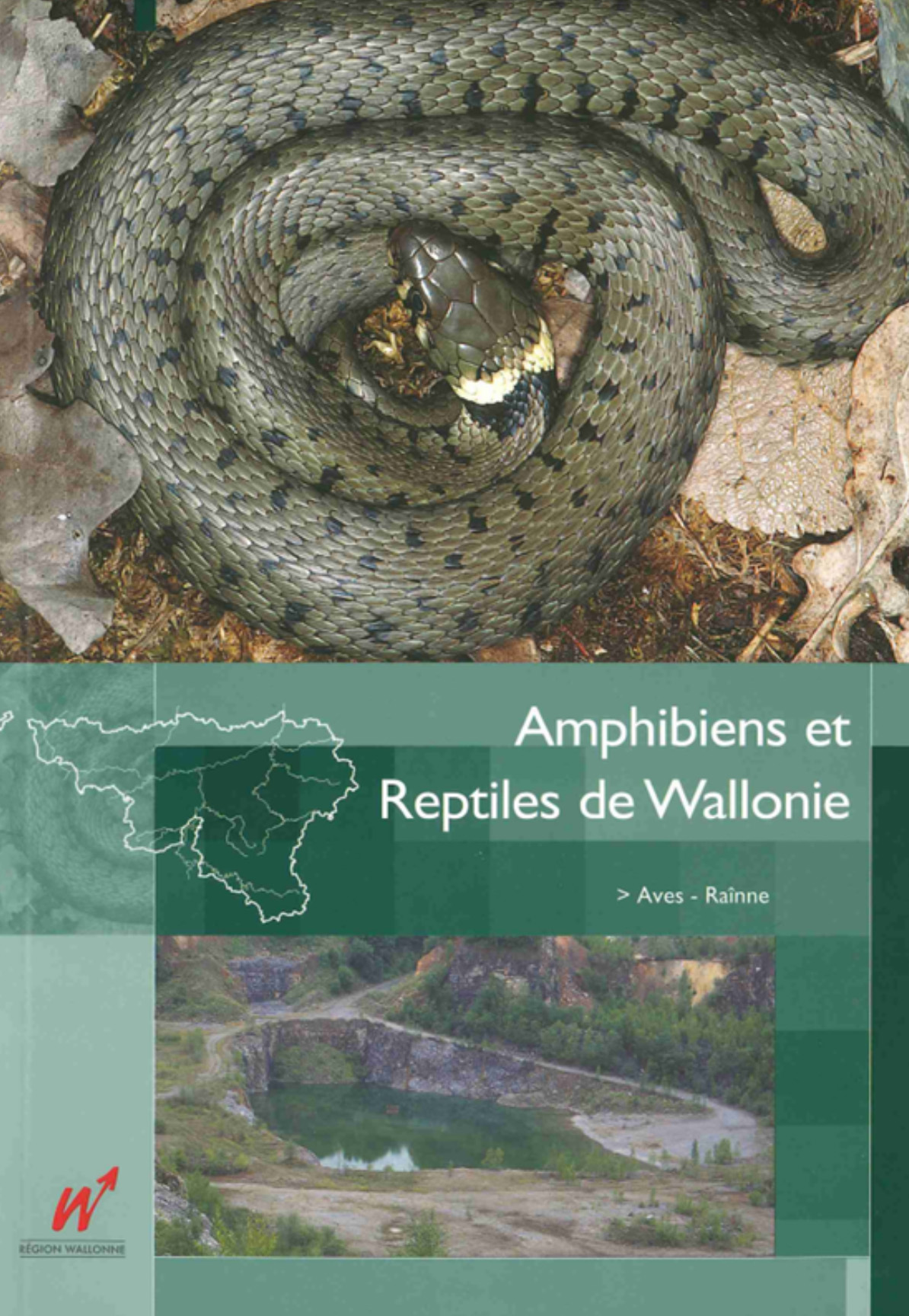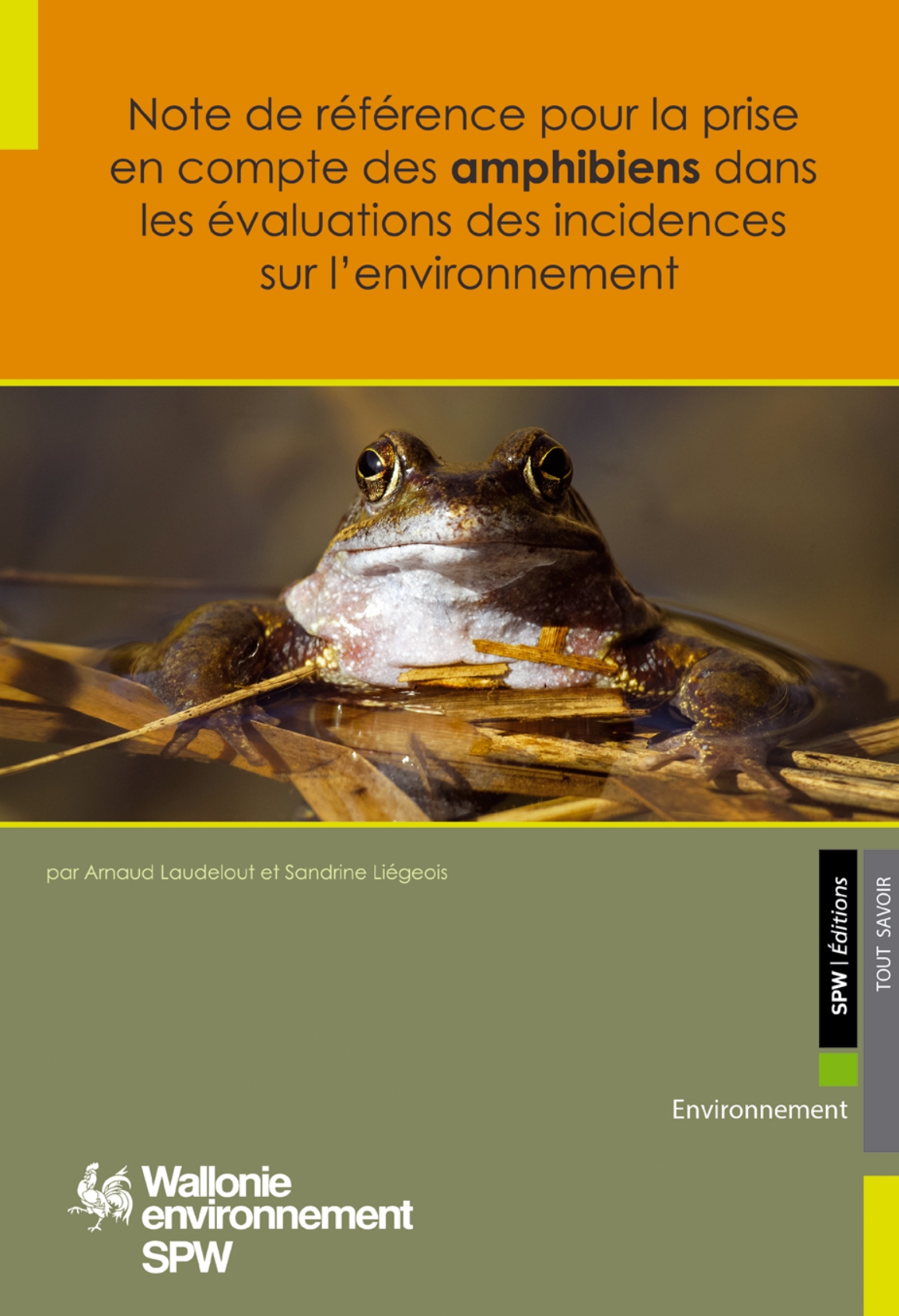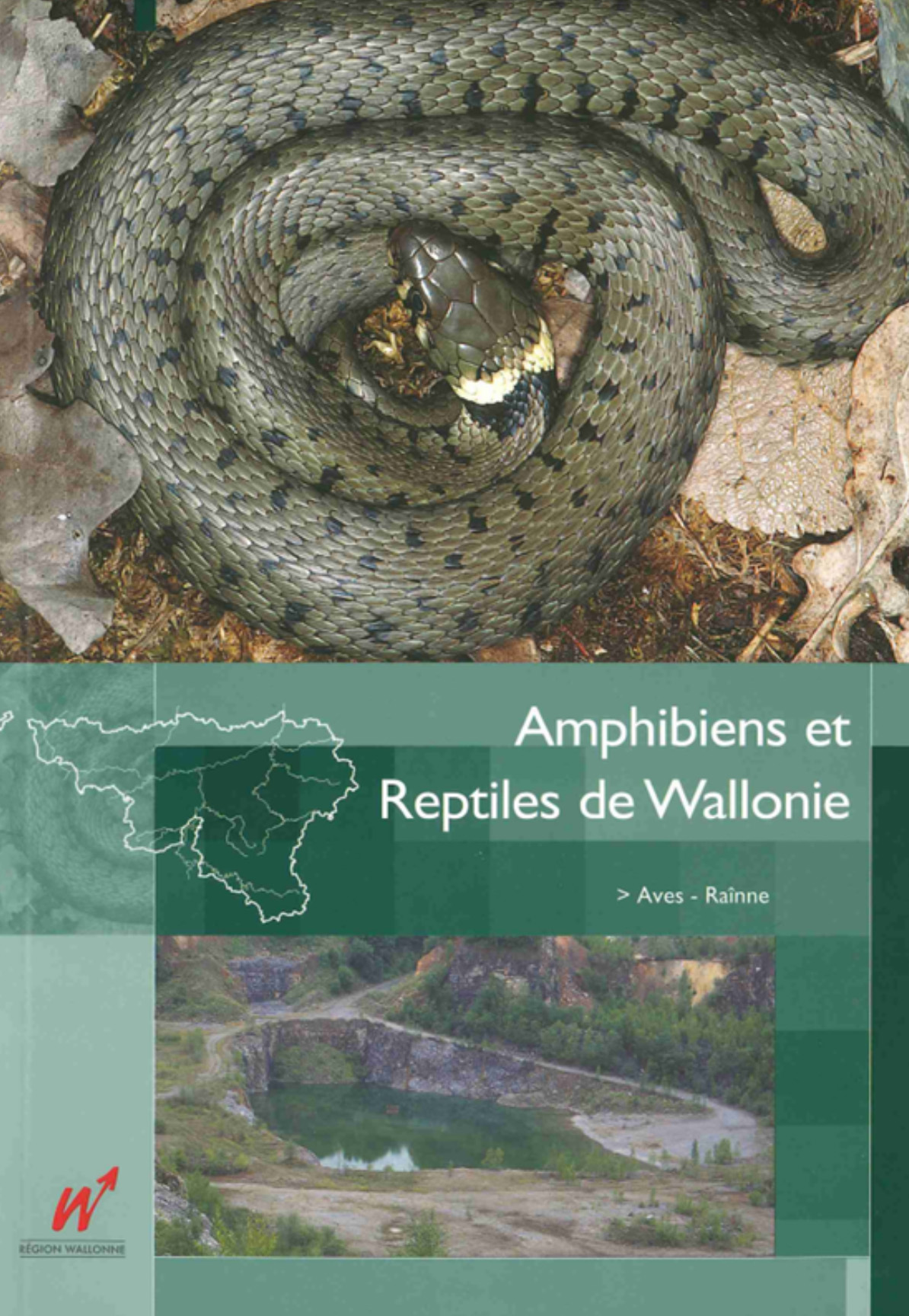

Le suivi des amphibiens
Les amphibiens sont un des groupes d’animaux parmi les plus menacés à l’échelle du globe. La moitié des 7000 espèces connues sont en effet en déclin et un tiers des espèces sont en danger d’extinction à court terme. En Wallonie, le nombre d’espèces considérées comme menacées reste encore modéré, mais des diminutions nettes sont enregistrés chez la plupart des espèces, même parmi les espèces les plus répandues telle la Grenouille rousse. Le suivi de leurs populations est donc de plus en plus crucial à assurer, en parallèle avec les actions de conservation qui sont menées, notamment dans le cadre de projets Life.
Menaces
Les menaces expliquant leur déclin sont très diverses et comprennent :
- La disparition et la dégradation des milieux aquatiques ainsi que l’intensification des milieux terrestres environnants ;
- La pollution par les pesticides, les sels de déneigement ;
- Le dérèglement du climat et en particulier les épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et sévères
- L’augmentation de certains prédateurs (poissons d’élevage, hérons, raton laveur…) ;
- Les maladies spécifiques transmises par des agents divers (virus, bactéries, champignons chytrides…), dont certaines importées, qui déciment certaines populations (salamandre notamment), et qui peuvent agir en interaction avec le climat ;
- La concurrence avec des espèces d’amphibiens introduites (Grenouille rieuse, Xénope lisse, Grenouille taureau…).
Milieux, cycles d’activité et observation
La plupart de nos amphibiens mènent une vie principalement terrestre et surtout nocturne et donc discrète pendant la plus grande part de l’année, durant laquelle ils fréquentent des milieux frais, suffisamment humides et abrités (prés humides, bois, …). L’eau étant indispensable au développement des œufs (dépourvus de coquille) ainsi que des larves, ils rejoignent toutefois les milieux aquatiques pour la reproduction, chaque espèce ayant ses préférences quant à la physionomie de ces habitats, en ce qui concerne la profondeur et l’importance de la végétation aquatique. De même, la période de reproduction, située généralement au printemps, varie d’une espèce à l’autre, mais aussi d’une année à l’autre chez une espèce donnée, en fonction des conditions climatiques particulières de la saison. En hiver, la plupart des espèces hibernent à l’abri dans des terriers, des trous au pied des arbres, sous des tas de bois, ou en s’enterrant dans le sol humide.
Ces éléments ne facilitent pas la recherche et l’observation des amphibiens qui nécessitent des sorties à des moments et en utilisant des techniques variant en fonction des milieux et des espèces visées, de jour comme de nuit.
Techniques de recherche
La détection des amphibiens fait appel à une série de techniques d’échantillonnage, directes ou indirectes.
Observation directe
Elle comprend des recherches visuelles aussi bien qu’auditives, en milieu terrestre comme aquatique et peut concerner tous les stades de développement dans ce second cas. L’usage de jumelles est souvent profitable autour des pièces d’eau. En milieu terrestre, l’inspection des abris naturels (pierres, bois mort…) est utile en journée. De nuit, les parcours effectués munis d’une lampe de poche ou frontale peuvent être fructueux, surtout en période de reproduction ou de migration entre milieux terrestres et aquatiques. Enfin, les chants caractéristiques émis en journée ou la nuit par les mâles de la plupart des anoures (grenouilles et crapauds) lors de la reproduction permettent de repérer et identifier les espèces présentes, voire de les dénombrer dans certains cas. Ces recherches peuvent être effectuées de façon opportuniste et aléatoire ou via des protocoles standardisés, le long de parcours définis ou dans un temps déterminé (15 minutes par exemple).

© Ralph
Capture au filet troubleau
La pêche au filet troubleau ou à l’épuisette est surtout utile pour rechercher les amphibiens (notamment tritons adultes et têtards) dans les points d’eau encombrés de végétation ou turbides. Les animaux capturés doivent être relâchés rapidement après détermination ou maintenus temporairement dans un seau ou une bassine avec de l’eau.

© Life Elia
Piégeage avec nasses
Les nasses à tritons sont un moyen efficace de de recenser ces animaux en période de reproduction dans les mares, mais nécessitent certaines précautions (cf. encart « à savoir »). Ces nasses comportent une partie émergée permettant aux individus d’aller respirer à la surface. Les nasses sont disposées dans l’eau en soirée et relevées le lendemain matin.
Abris artificiels
Durant leur vie terrestre, les amphibiens utilisent souvent des abris naturels tels que des pierres ou des tas de bois. La méthode consiste à multiplier ces refuges en déposant sur le sol des planches (de bois marin par ex.), des vieilles tuiles, des plaques de tôle ondulée ou des pièces de caoutchouc, qu’on pourra soulever lors des visites sur les sites ainsi équipés. Ces abris sont prisés notamment des alytes, crapauds commun et calamites, mais aussi tritons et jeunes de l’année lorsque disposés non loin des sites de reproduction.


© Rainne
Barrières et pièges-trappes
Cette technique permet de piéger les amphibiens en déplacement lors des migrations saisonnières entre les milieux terrestres et de reproduction. Le principe est d’intercepter les animaux en installant une barrière flexible au pied de laquelle sont enterrés des pots ou seaux dans lesquels les amphibiens tombent en longeant la barrière. Les pièges-trappes doivent être relevés chaque jour tôt le matin pour éviter que les animaux ne se dessèchent ou ne soient victimes de prédateurs.
Toutes nos espèces d’amphibiens étant protégées à des degrés divers, il est nécessaire de demander des dérogations pour pouvoir les captures, les piéger et la manipuler. Une fois une dérogation obtenue, il convient ensuite de prendre une série de précautions d’hygiène et de désinfection du matériel (bottes, filet troubleau, nasses…) pour ne pas contribuer à disséminer les pathogènes fatals pour les populations.
Seules les grenouilles vertes (du genre Pelophylax) passent la plus grande partie de leur vie active dans ou autour des pièces d’eau et des marais et y sont aisément observables. Cependant, ce groupe forme un complexe d’espèces dans lequel l’hybridation joue un rôle important. Ceci complique notablement l’identification de ces grenouilles qui repose sur des critères multiples, morphologiques, de coloration, sonores (chant), mais plus sûrement encore génétiques.
Détecteurs sonores et pièges photos
Ce type de dispositifs d’enregistrement automatique n’est pas encore fréquemment utilisé chez nous pour les recensements d’amphibiens, mais ils sont appelés à se développer dans le futur. Des modèles de pièges-photos sous forme de tunnels immersibles dans l’eau, conçus par des collègues du Grand-Duché de Luxembourg, sont même en cours de test pour la détection et l’identification des tritons.
Programmes et méthodes de suivi
Les amphibiens de Wallonie sont inventoriés et monitorés depuis 1996 dans le cadre du programme ISB (Inventaire et Surveillance de la Biodiversité). Etant donné les moyens limités, le programme se focalise surtout sur les espèces Natura 2000, avec des méthodes de suivi variant en fonction des espèces, mais lors des relevés, des données sont recueillies à propos de toutes les espèces d’amphibiens rencontrées en Wallonie.
Suivi de la distribution géographique
Espèces concernées : toutes les espèces wallonnes indigènes (Triton alpestre, Triton ponctué, Triton palmé, Triton crêté, Salamandre terrestre, Grenouille rousse, Grenouille verte, Grenouille de Lessona, Rainette verte, Crapaud commun, Crapaud calamite, Alyte accoucheur, Sonneur à ventre jaune), ainsi que les espèces introduites (Grenouille rieuse, Grenouille de Bedriaga, Grenouille taureau, Xénope lisse ,…)
Toutes les observations d’amphibiens, fortuites ou non, d’espèces communes aussi bien que d’espèces rares, sont utiles et peuvent servir à préciser leur distribution, dans l’espace et le temps. Il est donc recommandé d’encoder sur les portails en ligne toutes vos données, même récurrentes à un endroit donné. Les photos sont par ailleurs bienvenues afin de pouvoir valider les identifications.

© Marion Winkels
Contrôle des stations d’espèces Natura 2000

© David Delon
Espèces ciblées : Triton crêté, Crapaud calamite, Alyte accoucheur, Sonneur à ventre jaune, Rainette verte, Grenouille de Lessona, Grenouille verte +
Le principe est ici de visiter en rotation et à intervalles de quelques années au moins la majorité des stations connues des espèces les plus menacées ou moins fréquentes afin de vérifier le maintien de populations. Étant donné la faible détectabilité des amphibiens, deux ou trois visites effectuées par conditions favorables, sont préconisées, au minimum lors d’une année de contrôle, afin de pouvoir contacter les espèces visées et conclure au maintien de celles-ci sur les sites. Ces données sont traitées ensuite en présence/absence ou détection/non détection à l’aide de modèle statistiques adaptés.
Suivi de l'effectif des populations des espèces rares ou menacées
Espèces ciblées : Sonneur à ventre jaune, Rainette verte, (Triton crêté), (Salamandre tachetée)
Ce suivi est réservé aux professionnels et amateurs éclairés du Pôle Raînne. Il cible surtout deux espèces faisant l’objet d’opérations de réintroduction et combine éventuellement plusieurs méthodes : les sites sélectionnés sont visités régulièrement durant la saison favorable par conditions adéquates et les amphibiens sont comptés le long de parcours longeant les mares, étangs ou flaques favorables à leur reproduction, soit de jour (sonneur), soit de nuit à l’écoute de leurs chants (rainette verte). Les sonneurs sont photographiés dans une boîte transparente (type boîte de Pétri) afin de permettre l’identification des individus sur base de leurs motifs ventraux, ce qui permet alors des estimations d’effectifs par les méthodes d’analyses de données de « capture-marquage-recapture » ou CMR, plutôt que des mesures d’abondances relatives fournies par les comptages.

© Kathy Büscher

© Tobias Nöff
Des campagnes sont également commandées au besoin afin de suivre l’évolution de certaines populations de Triton crêté et de Salamandre terrestre dans les régions où ils sont touchés par le champignon pathogène Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Des nasses sont généralement utilisées pour estimer les populations adultes de la première espèce en période de reproduction, et pour la salamandre, des comptages des adultes sont effectués le long de transects en forêt la nuit ainsi que des comptages de larves de 15 minutes le long des petits rus forestiers. La piste de l’ADN environnemental a également fait l’objet d’un marché public afin de chercher à faciliter la détection du pathogène Bsal dans les mares.
Le Pôle Raînne (Natagora)
Le Pôle Raînne est un Groupe de Travail fondé en 1985 et rassemblant amateurs et professionnels au sein de l’association de conservation de la nature Natagora. Il a pour objet l'étude et la protection des amphibiens et reptiles en Wallonie et à Bruxelles.
Le groupe Raînne assure le suivi des populations d’amphibiens en Wallonie depuis les années ’90 grâce à des conventions annuelles, et plus récemment des marchés publics sous la direction du DEMNA (DNE).
Le pôle publie une à deux fois par an une publication servant de feuille de contact aux membres et contenant des articles divers au sujet de l’herpétofaune : synthèses de mémoires et de thèses, suivis de populations, articles de fond, relevés d'observations, actualités : « l’Echo des Rainettes ».
En savoir plus
Groupe de travail Raînne
Ce groupe de l'association Natagora assure le suivi des populations d'amphibiens en Wallonie depuis les années '90.
Note de précaution pour les inventaires faunistiques
Le document alerte sur la propagation de maladies fongiques graves chez les amphibiens en Wallonie (chytridiomycose et Batrachochytrium salamandrivorans) et recommande des mesures strictes de désinfection pour éviter une épizootie.
Publications